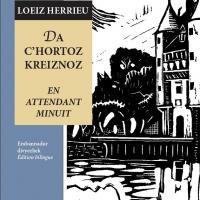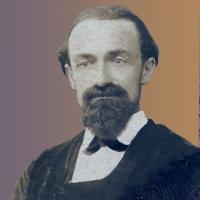Trois modalités de production ou l'instrumentalisation de l'art
L'instrumentalisation a-t-elle à voir avec l'instrument selon Jean Gagnepain ?
Il y a la forme et le contenu. La forme structurale vient en ergologie médiationniste en second temps d'une mise en forme naturelle de notre capacité de mouvement : appelons cela praxie, motricité, kinésie, ou Gestalt gestuelle. Cette structure émerge en même temps qu'une façon de ne pas faire qui revient sur le premier temps de l'action en analysant, élaborant, des moyens et des fins techniques en nombre et en qualités limités. Le troisième temps de la dialectique explique la production, laquelle tend à rendre efficaces les fonctionnements tous azimuts des moyens et des fins techniques. La recherche de l'efficacité correspond à l'instinct animal qui perdure en nous consistant à mettre en rapport le moyen avec la fin de façon indissociable : ce qui veut dire qu'un asservissement est à l'oeuvre dès lors que le constructeur qui n'est pas seulement technicien a en vu une chose à faire, c'est-à-dire pas n'importe quoi. Tel moyen élaboré se trouve donc asservi à cette finalité particulière de l'affaire entreprise : c'est l'instrumentalisation de l'art que Jacques Laisis désignait encore par les termes d'action outillée où l'action (l'instrument) rencontre la technique (l'outil) en réaménageant celle-ci pour la rendre adéquate.
On voit ainsi comment la forme se remplit en quelque sorte par un contenu qui n'est autre que l'équivalent de l'objet : le trajet. Celui de l'écriture n'est pas que lisible par la technique du signal de signe, il est visible par celle du signal de symbole.
Pour analyser la déictique de l'écriture, les concepts de trait, de ductus, de caractère et de graphe sont avancés par Hubert Guyard et Attie Duval dans leur article « Au pied de la lettre » dans le °3 sur l'ergologie. Il faut étendre ce rapport pratique (empirique) à l'écriture pour considérer qu'il n'existe pour le constructeur, écrivain autant qu'apprenti, qu'en coexistence avec le magique et la plastique.
L'art est ainsi instrumentalisé de trois façons :
pratiquement
magiquement
plastiquement
Développer ce point, c'est reprendre les trois modalités de production énoncées par Jean Gagnepain en les situant dans le rapport dialectique à l'activité.
Deux fois huit rapports1 sont à nommer pour cristalliser cette extension écrit-lyre de l'écriture dont les rudiments sont déjà là à travers les manquements et les maladresses, les gribouillis comme les fantaisies, autant parler des bases d'une créativité. Reprenons le tableau synoptique (in La couleur produite et productible, tétralogiques n°23) pour en faire ...une sorte particulière de chapeau d'Arlequin à trois entrées :
Pratique : trait, ductus, caractère, graphe
Magique : flèche, ruban, tour, enluminure
Plastique : texture, patte, arabesque, calligraphie
Le rapport plastique au trait nous verse dans la calligraphie pour une orientation et une fragmentation qui n'est plus dans la transcription d'un sens unique à produire, mais dans une arabesque qui cherche les courbes et les contre-courbes, la répétition des droites comme un rythme en tirets, vibrant de texture.
La covalence devient métagraphe par l'association d'un trait avec un autre qui lui est proche ;
le type est à revisiter en isomorphisme tels l'écriture bâton, la cursive, l'elzévir, etc.
La covariance, qui fait parler de passage, définit l'assomption de l'écriture en attaché à l'attache, celle de la page au format ;
la syndèse qui unifie le mot en ligatures.
Ainsi, le graphisme est chargé non pas de résonances, assonances et consonances mais de ligatures qui refont les mots sur des pages trajectiles, pour reprendre le subjectile nommé par les esthéticiens de l'art, ce rapport spécifique de la peinture au support, au format qui n'est pas loin de l'écriture.
Le rapport magique à la lyre de l'écrit établit une fée qui détient (fabrique) ses pouvoirs par la fabrication. Ce n'est pas très loin de l'intelligence artificielle, IA, qu'elle prend ses fonctions ; on la nommera donc écrivaine automatique EA (rapport magique au graphe) qui exploite le tour (rapport magique au caractère) chapeau d'Arlequin sur la tête, par coups de baguette à ruban (rapport magique au ductus), un rapport magique au trait: la flèche.
15-04-23
Plastique :
La texture désigne cette attention aux qualités sensibles de l'encre: largeur du trait, épaisseur, aplat, qui déterminent des variations de régularité des lignes ;
la patte est à comprendre au sens du coup de patte du peintre ou dessinateur : ce qui se fait d'un seul coup avec facilité ;
l'arabesque nous verse dans le rapport esthétique des lignes entre elles : courbes et contre-courbes, contraste des lignes par leurs orientations et inflexions ;
La calligraphie est le moment où s'affiche une unité d'action outillée : le tracé se regarde et ce qui s'y fait est en reprise de ce qui s'est fait.
Magique :
La flèche nous rend attentif à l'orientation et la fragmentation dans le cadre du segment de trait : hauteurs limitée des lettres, changements de direction interne tous ces mouvements voudraient porter de la puissance et cibler son effet, ce qu'évoque la pointe de la flèche et son empennage ;
le ruban rejoint la baguette de la fée munie d'un ruban qui amplifie les mouvements de l'écriture : les lettres se dessinent alors dans l'espace au bout de sa baguette magique ;
le tour combine le tour de main au tour de magie : c'est une opération magique qui entre dans la danse, en convergence avec d'autres ;
l'enluminure nous place face au résultat d'une convergence des tours qui enchante l'espace et le convertit en lumières et couleurs pour nous séduire.
Pratique : (reprenons en résumé l'analyse de Hubert Guyard et Attie Duval)
Le trait : ce qui différencie au minimum dans la lettre elle-même un fragment d'un autre par son orientation et sa longueur;
Le ductus : ce qui se fait d'un seul geste en continu et ce n'est nécessairement pas la lettre entière ;
Le graphe : ce sont tous les mouvements qui composent la lettre se différenciant des mouvements des autres lettres. Prime alors la différenciation d'une lettre à l'autre ;
Le caractère: ce qui sépare les graphismes en cadres de graphes formant des mots. La segmentation du gaphisme en débuts et fins est ici importante.
(Point critique : la lecture rangée en typographie et l'écriture en stylographie)
Revenons encore sur la pratique pour faire valoir le retour de l'action dans la production :
Il s'agit alors de considérer un asservissement des matériaux de la stylographie à la lettre à tracer ou de la typographie à la lettre à localiser. C'est donc le moyen et la fin de l'action outillée qui sont à prendre en compte.
Le trait est trajectivé en moyen instrumental, asservi à la ligne à produire. À commencer par le pouvoir suffisamment contrastant de l'encre dans le rapport au papier, vectorisé pour une visibilité, le matériau pouvoir de liquidité, vectorisé en un épanchement utile pour aller dans le sens de la ligne de la lettre ; celui de la capillarité, vectorisé pour charger la pointe.
Qu'en est-il du stylo à bille ? La bille précisément correspond à une autre technique qui consiste dans débit de l'encre par frottement et la viscosité de l'encre qui entre en résistance est ainsi gérée.
Le ductus ou rapport pratique à l'engin de l'écriture (ustensile), qualifie la convergence des matériaux en un faisceau de vecteurs mis en action d'un seul coup de main, en un seul geste.
Le graphe porte en lui la conciliation entre une linéarisation à laquelle suffit un déplacement d'une pointe en contacte avec une surface absorbante et une orientation direction de la lettre à produire. La localisation du début du tracé mobilise toute l'attention, de même que sa fin contre l'articulation et contraction de la main et de ses doigts.
Quant au caractère, l'orientation et la fragmentation propres à la principale machine de l'écriture ne sont autres que la résultante de l'appareillage d'une linéarisation-chromatisation par articulation-contraction musculo-squelettique.
Cette analyse se manifeste autrement s'agissant de la typographie mais, celle-ci n'est pas plus téléologique que la stylographie et la lecture ne tient pas plus à cette dernière que l'écriture ne tient à la stylographie. Ce qui a lieu n'est que la transaction chez le même constructeur de deux techniques. Car l'apprentis écrivain est constructeur de sa propre écriture, mais exploitant de la technique de l'autre et il ne peut que s'y méprendre : un autre trajet se construit de ce fait.
La différence principale entre la pratique de la frappe au clavier et le manuscrit de la cursive est la localisation doublée d'une automaticité chez l'imprimeur mais absente dans l'écriture liée ou pas de la stylographie. Ainsi, le télescopage des lettres a lieu qui embrouille le regard du lecteur en conséquence d'une écriture qui se télescope. Tout cela est possible parce que l'apprentis écrivain dispose de la seule technique du dessin avant de commencer à écrire. La localisation des touches est le seul exercice d'attention utilisé par le typographe qui s'ignore. La pratique du portable ne modifie que partiellement la manoeuvre en ajoutant un glisser au glisser-cliquer de l'index qui s'apparente à la frappe au clavier.
L'écriture typographique est une aide à la lecture au sens où elle organise la séparation des lettres et des mots. Ce qui évite la dyslexie du stylographe.
Il y a pourtant du trait chez le typographe lecteur et il peut ainsi confondre le i avec le r, le I et le l, le O et le 0, le p avec le q, le b avec le d, etc. Méprises que voulaient corriger les imprimeries artisanales et scolaires du groupe « Freinet ». Un certain contact se produit de l'encre avec la feuille de papier où les pâtés sont alors fréquents, négligés par l'imprimeur averti et trompeurs pour les néophytes. Ce ne sont plus les pouvoirs de liquidité et de capillarité qui sont alors mis en action mais de la viscosité et de l'adhérence, matériaux vectorisés en contrastes visualisables pour former toute ligne à percevoir.
En résumé, l'instrumentalisation de l'art est le fait de la production où ce qui se produit n'est retenu que s'il va dans le sens de la production visée. De sorte que des matériaux-moyen et des matériaux fin résultent d'une mécanologie revisitée éventuellement contrecarrée. Une téléotique spécifique en résulte qui s'empare des moyens de fabrication pour les convertir en moyen et fin de l'action en cours. Inversement, des machines-moyens comme des machines-fins constituent des appareillages par une mécanique particulière d'adéquation des dispositifs.
17-04-23
1Les deux faces, les deux axes et leur projection réciproque : similarité et complémentarité